2ème épisode : Ça tombe comme à Gravelotte!
Dans ce deuxième épisode, nous suivrons les troupes françaises du 20 juillet (premier jour de guerre) jusqu'à la capitulation du 2 septembre 1872, toujours en ayant comme principe de nous référer aux sources de l'époque, en France et en Allemagne. Les propos sont sévères pour notre grande nation. Ils mettent en évidence le goût du secret, mais aussi une tendance aux mensonges d'État - des fake news comme on dit aujourd'hui, notre pudeur allant jusqu'à préférer la litote anglo-saxonne au mot sans doute trop dur de nos dictionnaires. Nous y verrons les ego d'hommes diriger l'Histoire, comme souvent, et l'intérêt général instrumentalisé pour servir un destin individuel plutôt que tendre à un bon gouvernement.
N'hésitez pas à consulter la galerie de portraits que j'ai constituée ici. Vous y retrouverez les principaux personnages de ce blog, croqués par Touchatout dans son Trombinoscope. Vous ne serez pas déçu du détour.
* *
300.000 hommes d’un côté et 500.000 de l’autre ; de la cavalerie d’un coté et de l’artillerie lourde de l’autre. Des baïonnettes, des chevaux, du côté français, mais aussi de l’impéritie, l’ignorance, disons le mot : le gâtisme de la plupart de nos généraux[1] face aux stratèges prussiens : voilà en quelques mots la défaite annoncée. Les Français, sont mal préparés à la guerre, et leurs généraux gâteux ne s’intéressent guère à la stratégie. Maxime Du Camp en donne une illustration, quand il rencontre le 30 juillet le général D***. Tout en bavardant, je lui dis : « Le dépôt du ministère de la Guerre vous a-t-il expédié vos cartes ? » Que de fois sa réponse m’est revenue au souvenir ! Il se mit à ricaner et, en goguenardant, il me répondit : « Ah ! vous voilà bien, messieurs les savantasses ! Les cartes, la géographie, la topographie, c’est un tas de foutaises qui ne servent qu’à embarbouiller la cervelle des honnêtes gens.[2]Du côté prussien, il en va bien différemment : L'invasion allemande de 1870 était d'ailleurs autrement réglée et mathématiquement exécutée (…). Les uhlans, connaissant un hameau à une grange près, une route en quelque sorte, arbre par arbre, sont devenus légendaires. (…) Ces soldats marchaient en quelque sorte une carte à la main, semi-espions et semi-géographes. C’est encore une science toute allemande, et qui fut jadis une science française, c’est la géographie qui nous a perdus. Sur ce point, l’ignorance de nos officiers était proverbiale, et pourtant, c’est sur l’excellente carte de notre état-major que se guidaient les Allemands pour passer à travers nos sentiers et nos routes. On n’avait distribué, hélas ! à nos soldats, à cette armée du Rhin destinée à assiéger Mayence et Rastadt que des cartes d’Allemagne.[3]
Le désordre règne au sein de l’état-major et les généraux français se détestent entre eux. Maxime Du Camp en témoigne avec malice en citant le commandant de la garde impériales, Bourbaki, que j’interrogeais, leva les épaules et me répondit dans son langage qui parfois rappelait un peu la caserne : « Ça, des généraux ! laissez-moi tranquille : ce sont des moulins à paroles, pas autre chose. »[4]
Les Français ne veulent pas de cette guerre : Elle fut tout de suite impopulaire, au point qu’il fallut embaucher tous les policiers disponibles afin qu’ils étouffassent sous leurs cris de victoire et leurs chants guerriers les murmures qui s’élevèrent de toute part. Il est important d’établir ainsi, preuves à l’appui, que l’Empire n’eut pas même l’entrainement national pour excuse à sa folle et désastreuse résolution. C’est malgré nous et malgré tous les Français doués de quelque bon sens qu’il la prit et qu’il l’exécuta.[5] Napoléon III affirme, sans rougir, auprès de Bismarck, que lui-même n’avait pas voulu la guerre, mais qu’il y avait été forcé par la pression de l’opinion publique en France.
C’est dans cette ambiance que l’empereur va lui-même diriger ses troupes, sur le front, ajoutant ainsi aux approximations stratégiques. L’impératrice Eugénie devient régente, et joue à la Maréchale. Rochefort s’en amuse : Mme Eugénie, impératrice et régente, télégraphiait aussi son plan de campagne : « J’ai de mauvaises nouvelles de l’empereur. L’armée est en retraite. Je rentre à Paris où je convoque le conseil des ministres ». Puis une autre à son mari où elle déclare que le général de Failly n’ayant pas été à la hauteur de sa tâche, il faut le remplacer par le général de Wimpfen. Et le bon gaga répondait : « J’accepte Wimpfen à la place de Failly. » Vous imaginez-vous Joséphine écrivant à Napoléon Ier : « Je trouve qu’à Austerlitz, Bernadotte a été insuffisant. Il faudrait le remplacer par Davout. » et Napoléon répondant « Puisque ça te fait plaisir, j’ai mis Davout à la place de Bernadotte » ? Et plus loin : Les ministres, dont cette impératrice de féerie présidait si drôlement les conseils, essayaient encore de donner le change sur l’immensité de nos désastres.[6]
Durant la deuxième quinzaine de juillet, point de combat. Il faut d’abord équiper et réunir les troupes. A cette occasion, on se rend compte que l’intendance ne suit pas, que beaucoup de recrues prennent le large. Tel homme habitant Dunkerque devait se rendre à Perpignan pour l’équipement et repartir pour l’Alsace. L’état-major comptait sur la mobilisation de 160.000 réservistes. Fin juillet, il n’en compte que 40.000. Le maréchal Le Bœuf, qui a décidément le sens de la formule, levait les bras au ciel et disait : « que voulez-vous que j’y fasse ? on m’a trompé, on s’est joué de ma bonne foi ; on a abusé de ma loyauté ; les états qu’on m’a remis sont faux ; il me manque 12.000 hommes, que voulez vous que j’y fasse ?[7]. Et il s’apercevra, mais trop tard, que beaucoup de blessés mourront faute d’ambulances.
Citer toutes nos défaites tourne à l’exercice fastidieux : celle Wissembourg, le 4 août, n’inquiète pas les bourgeois : la bourse reste stable ! Mars-La-Tour, le 14 août n’aurait pu être qu’une défaite. Ce fut plus que cela. En ne lançant pas la contre-offensive redoutée par les Prussiens[8], Bazaine coupe son armée (du Rhin) de celle de Mac-Mahon (du Nord). Le 16 août, Strasbourg est assiégée – un siège qui durera jusqu’au 28 septembre.
Le 18 août, nouvelle et célèbre déconfiture, celle de Gravelotte pendant laquelle Français et Prussiens s’échangèrent de la mitraille comme jamais. Les Prussiens n’en menèrent pas large et sentirent le vent de la victoire souffler – ils eurent d’ailleurs beaucoup plus de victimes que n’en comptèrent les Français, officiellement tout au mois. Mais cela, Bazaine ne le savait pas, ou feignait de ne pas le savoir, car par trois fois, entre le 14 et le 18 août, il aurait pu faire reculer les Prussiens, et, soutenu par l’armée du Nord (celle de Mac-Mahon), les poursuivre chez eux. Mais non, Bazaine se replie, s'isolant à Metz plutôt que de marcher en direction de Verdun, rejoindre Mac-Mahon et l’empereur, ainsi qu’il l’avait promis. Il demeure à peu près incontesté, lit-on dans le Trombinoscope, qu'il choisissait invariablement le moment où il pouvait s'éloigner de Metz pour y rentrer. Ce repli désastreux fut salué comme une victoire à Paris. On crut à une journée décisive en faveur des armes françaises, et l’on discuta en Conseil des ministres si l’on ferait tirer le canon à l’Hôtel des Invalides et illuminer les Invalides.[9]Ainsi encerclée, Metz était neutralisée. Le temps que Mac-Mahon, qui attendait Bazaine, arrive, la route vers Paris était ouverte aux armées de Guillaume 1er. S’il avait pu, Bismarck aurait baisé Bazaine sur le front ! aurait pu dire Rochefort, adepte des doubles sens.
Malgré la déconfiture en cours, le ministre de la guerre, le comte de Palikao, affirme encore le 30 août : Les Allemands, depuis leur entrée en France, ont perdu plus de deux cents mille hommes ; ils ne peuvent plus supporter les frais de la guerre ; d’ici à deux ou trois semaines, nous les auront tous reconduits chez eux ![10]
Bazaine piégé de son propre fait, les troupes de Moltke s’attaquent alors à Mac-Mahon et à l’Empereur en personne, du côté de Sedan. C’est le coup de grâce, la capitulation (2 septembre). Bilan : un Empereur malade détenu en compagnie de 39 généraux et près de 100.000 soldats, 650 canons, 66.000 fusils… Seule satisfaction, le bon comportement des troupes de marine à Bazeille : nos amiraux, pourtant absents du champs de bataille, en récolteront les fruits lors des premières élections législatives de la future IIIème République.
Le 2 septembre, Bismarck peut de nouveau fumer son cigare avec le sentiment de la mission accomplie :la France est déconfite, et, ce n’est qu’une question de quelques jours, Paris sera encerclé. Quant à Napoléon III, il aurait bien pu se réfugier en Belgique. Qu’est-ce que cela fait ? S’il prenait une autre direction, il n’y aurait pas de mal, dit Bismarck.[11]
Bazaine sera condamné à la peine de mort avec dégradation militaire pour avoir capitulé en rase campagne, traité avec l'ennemi et rendu la place de Metz avant d'avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait.
La capitulation est un fait établi, mais traiter avec l’ennemi ? Bazaine serait-il allé jusqu’à volontairement servir la stratégie des Allemands - rompre le front des armées françaises du Nord et de l’Est, et avoir la voie libre vers Paris? Mais dans quel but ? Il se disait alors que Bazaine voyait avec un intérêt tout personnel une France vaincue par la Prusse, une Prusse garante de l'ordre établi. Pour cela, il se dit encore qu'il discutait en douce un jour avec Eugénie et l'autre avec Bismarck, faisant courir le bruit dans Metz que Paris était livré à l'anarchie républicaine. Bazaine fut-il un Pétain avant l’heure, rêvant d’une France débarrassée de ses républicains et de ses communistes – et dans laquelle lui-même, et surtout pas Mac-Mahon, aurait joué un rôle, et nous aurait protégé des excès allemands ? Si cela fut son pari, il l’a perdu, Mac-Mahon sera président de la République Française en mai 1873…
Sa peine sera commuée à vingt ans de prison sans dégradation par Mac Mahon lui-même : il lui devait bien ça, lui qui avait la position convoitée par Bazaine. On prête à Victor Hugo la réflexion suivante : Mac-Mahon absout Bazaine. Sedan lave Metz. L’idiot protège le traître[12]. La formule est séduisante. Mais peu importe que Bazaine fut un traître plus ou moins idiot et Mac-Mahon un idiot plus ou moins traître. Cet épisode de l’histoire de France met en scène un Empereur dont la faiblesse physique n’absout pas l’aveuglement et le ton assuré, cette forme si française de prétention politique qui fait prévaloir des intérêts personnels à peine cachés par ambitions de parti ; des généraux qui se font la guerre avant de la faire à ceux de l’autre camp ; une classe dirigeante plus préoccupée par une classe montante et menaçante, le prolétariat, que par l’intérêt général ; une classe dirigeante qui, finalement, préfère traiter avec l’ennemi qu’il pense être de son milieu, plutôt que répondre aux revendications internes.
Napoléon III a voulu régler une crise intérieure par la guerre. Bismarck, de même, avait aussi des préoccupations internes : l’avènement de l’Empire Allemand. Le premier a échoué par aveuglement. Le second y est parvenu par la volonté de construire un projet politique.
Combien de morts, combien de blessés, combien de prisonniers pendant cette première partie de la guerre de 1870 ? Les chiffres divergent, et pour les seules journées des 14, 16 et 18 août, celui de 75.000 morts, blessés ou disparus est parfois avancé.[13]
[1]Rochefort, op. cit. p. 186.
[2]Maxime Du Camp, Souvenirs d’un demi-siècle – Au temps de Louis-Philippe et de Napoléon III, p. 292 (Hachette, 1949)
[3]Jules Clarétie, Histoire de la Révolution de 1870-1871, 1872, page 200.
[4]Maxime Du Camp, Souvenirs d’un demi-siècle – Tome II, page 31.
[5]Rochefort, op. cit. p. 191.
[6]Rochefort, op. cit. p. 187.
[7]Maxime Du Camp, Souvenirs d’un demi-siècle – Tome II - La Chute de l’Empire et la IIIème République, page 12.
[8]« Il y avait des pertes sérieuses de notre côté, et ce n’est qu’à grand’peine qu’on avait pu empêcher Bazaine de force nos lignes… Nous sommes en nombre supérieur aux Français, et s’ils tentent une autre sortie, ce sera à notre tour d’être victorieux. Cela n’était, toute fois pas certain et nous nous sentions quelque peu inquiets. » Les mémoires de Bismarck recueillis par Maurice Busch, tome premier. (Charpentier, 1898),
[9]Maxime Du Camp, op. cit.p. 35.
[10]Maxime Du Camp, op. cit.p. 70.
[11]Maurice Busch, op.cit. page 110.
[12]Victor Hugo, Choses vues 1870-1885, Paris, p. 321 (Gallimard, Editions Folio, 1972).
[13]Institut Illiade- https://institut-iliade.com/ca-tombe-comme-a-gravelotte/


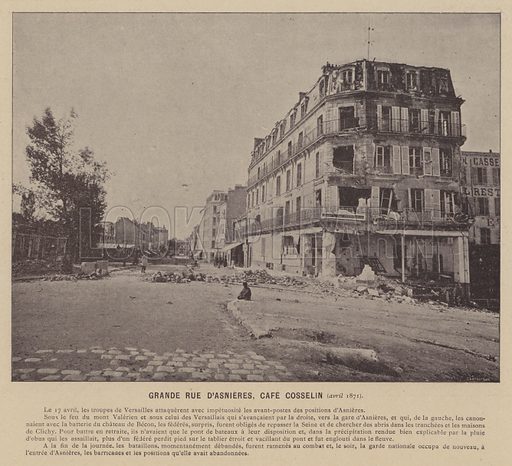
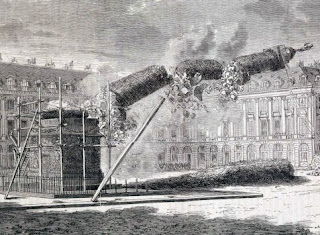

Commentaires
Enregistrer un commentaire